Ce que l’on ne pourra jamais enlever à François Ozon, c’est son appétence pour le cinéma. Depuis 1988 et son premier court-métrage, « Photo de Famille », il enchaîne avec boulimie les longs-métrages, afin probablement de nous démontrer ses capacités à tenir une caméra et à raconter des histoires. Certes…
Car parfois, rien ne sert de scander haut et fort son amour pour les films et le 7ème art, si c’est dans le seul but de se prouver à soi-même le bien-fondé de ses ambitions. François Ozon revient pourtant assez régulièrement à la charge, fort de quelques indéniables succès publics et des honneurs qui lui sont souvent rendus dans la presse. Alors, oui, en 23 ans de carrière, le réalisateur aura produit pas moins de vingt films, et c’est beaucoup…
Mais François Ozon a-t-il vraiment quelque chose à dire et l’énergie nécessaire pour le faire ? De l’énergie, il en a à revendre et il l’a déjà démontré, avec cette façon simple et directe d’enchaîner des projets sans aucun lien, les uns à la suite des autres, et cette capacité d’aborder tous les sujets, tous les thèmes au cinéma. Bref, il possède la carte, celle qui permet de monter tous les projets possibles. Et rares sont les auteurs en France à pouvoir jouir de tels privilèges.
Seulement voilà, comment résumer le cinéma de François Ozon ? Est-il le fils spirituel ou illégitime de Pedro Almodovar et André Téchiné, voire de Brian De Palma ? Tant le réalisateur de « Huit Femmes » oscille, hésite et ambitionne de manière aléatoire des films qui se voudraient dévastateurs, puissants, étranges, qui nous emportent, ou bien juste qui seraient drôles, acides et impertinents.
Car la force des cinéastes cités plus haut, en référence directe, c’est que leurs œuvres s’additionnent, se construisent au fil de la filmographie de leurs auteurs. On peut alors, en tant que cinéphile ou même simple spectateur, apprécier cette progression qui saute aux yeux, de film en film ; le fait qu’ils se répondent les uns aux autres dans une cohérence artistique évidente.
A l’inverse, en considérant la filmographie de François Ozon, on l’imagine non pas comme une abeille qui butinerait le pollen pour construire une œuvre (sa ruche…), mais plutôt comme une guêpe opportuniste qui se sert allègrement de ce qu’ont construit les autres, pour arriver à ses propres fins. Car Ozon a cette fâcheuse manie de nous convier à des récits qu’on a l’impression de déjà connaître…
Et il n’y a aucune pertinence, aucune surprise et encore moins de prise de risque dans ce que nous propose le réalisateur d’ « Une Robe d’Eté », tant tout semble évident et balisé. Son cinéma est confortable, quand il souhaiterait nous faire croire qu’il est subversif. Subversif, Ozon le fut parfois, avec son premier long-métrage, « Sitcom » (1998), puis avec « Huit Femmes » (2001) ou encore « Jeune et Jolie » (2013). Car ces trois films relevaient du parfait mélange entre douceur sucrée, acidité et amertume.
Sans pour autant faire référence à de grands noms du cinéma, on peut d’ailleurs trouver chez François Ozon des accointances avec un autre réalisateur français, qui tente lui aussi depuis des années de nous caser ce qui constituerait son chef d’œuvre : Patrice Leconte. Car il y a incontestablement chez ces deux cinéastes cette même envie, ce même besoin impérieux, de réaliser « le grand film », avec du souffle romanesque et de la virtuosité.
Tel un élève appliqué et un brin zélé, on retrouve ainsi chez Ozon tout ce dont il s’est nourri chez les autres durant des années. Outre les réalisateurs cités plus haut, on pourrait ajouter à la liste Buñuel et Chabrol, quand il évoque la bourgeoisie, en s’en moquant. La belle affaire, puisque tant Buñuel que Chabrol ont su, quant à eux, si bien décortiquer cette thématique sous divers angles qu’il devenait dès lors présomptueux de tenter de faire mieux, dans le registre de la farce, comme du polar ou de la caricature.
C’est avec le soutien indéfectible d’une presse en général dithyrambique, une alliée sur laquelle il a pu compter depuis ses tout débuts, qu’Ozon a pu ainsi continuer son petit bonhomme de chemin, sans ne jamais avoir à s’inquiéter ou devoir remettre en cause ce qu’il pense être un talent évident chez lui, celui de brasser avec tant de naturel et de facilité tout ce qu’il touche.
On retient donc, par pure politesse, des films tout au plus aimables, « Sitcom », « Huit Femmes », « Potiche », « Grâce à Dieu », « Eté 85 ». Mais souvent, lorsque lui vient des envies de cathédrales, on est abasourdi par tant de prétention et de vacuité. « Dans la Maison », « Une Nouvelle Amie », « Frantz », autant de films dans lesquels on sent François Ozon totalement perdu, entre la technique, le cadre, la mise en scène et le jeu des acteurs. Des productions sans aucune direction, aucun fond… On comprend néanmoins ce qu’il cherche à nous montrer, mais le problème, c’est que n’est pas Visconti, Verhoeven, Granier-Deferre ou Sautet qui veut…
Pour revenir à son dernier film, « Eté 85 », qui bénéficie du sticker « Sélection Officielle Cannes 2020 », là encore attribué par une presse majoritairement bienveillante à son égard, on ne peut que rester incrédule devant ce qui pourrait ressembler à un film de Jean-Daniel Cadinot, sans les scènes de sexe explicites, évidemment, s’il n’y avait pas autant de tapage à son endroit.
Ozon se sent obligé de rendre l’intrigue de son histoire tarabiscotée au possible, peut-être pour mieux créer une ambiance et un malaise, alors qu’avec « Eté 85 », il ne s’agit en fait que d’une petite histoire qu’Eric Rohmer aurait très bien pu porter à l’écran, s’il s’était plus intéressé aux amours homosexuels dans sa filmographie.
Tout ici est tortueux à souhait et faussement mystérieux, finalement pour pas grand-chose. Mis à part les deux acteurs principaux qui jouent là encore comme dans un film de Cadinot, tous les autres rôles secondaires tiennent plus de la caricature et du faire-valoir que de personnages à part entière. D’un côté, Isabelle Nanty, que l’on a connue un peu plus inspirée, incarnant cette mère prolétaire qui fait sans arrêt le ménage tout en épluchant frénétiquement des pommes de terre, et de l’autre, Valeria Bruni Tedeschi, encore une fois border line et peu servie par l’indigence des dialogues.
Peut-être eût-il été plus judicieux pour le réalisateur de transposer cette histoire d’amour entre deux adolescents de nos jours, plutôt que de la situer dans des années 80, à grand renfort de tubes de l’époque, pour jouer plus que de raison sur une nostalgie de bon aloi. Car, à part entendre « In Between days » des Cure en ouverture putassière du film, le fameux titre du groupe bien sorti en 1985, « Eté 85 » ne raconte rien d’autre, ni de cette année-là ni de cette période.
Une fois encore, on voit François Ozon se débattre, totalement incapable d’élargir le cercle de son histoire et du contexte dans lequel il a placé ses deux personnages principaux, pour les faire évoluer dans cette période bien précise. Mis à part une Renault 5 ou un peigne cran d’arrêt, nous repasserons, pour ce qui est du voyage dans le temps et la crédibilité de cette reconstitution temporelle bâclée.
Non, une fois de plus, tout cela relève de la supercherie et de la paresse intellectuelle, et tout reste fade et insignifiant. Quant à François Ozon, il s’avère incapable de faire briller ses acteurs au-delà de leur possibilité première. Il pourrait être un faussaire de talent, un peu à la manière d’un Quentin Tarantino, qui sait malaxer les références pour nous offrir des objets pop. Mais même ce travail de copiste échoue, car il n’y a pas, derrière, ce sens du travail bien fait, de l’artisanat, de l’orfèvrerie, qui pourrait nous épater, comme lorsque Brian De Palma revisitait les films d’Alfred Hitchcock, en un relecture brillante et inspirée.


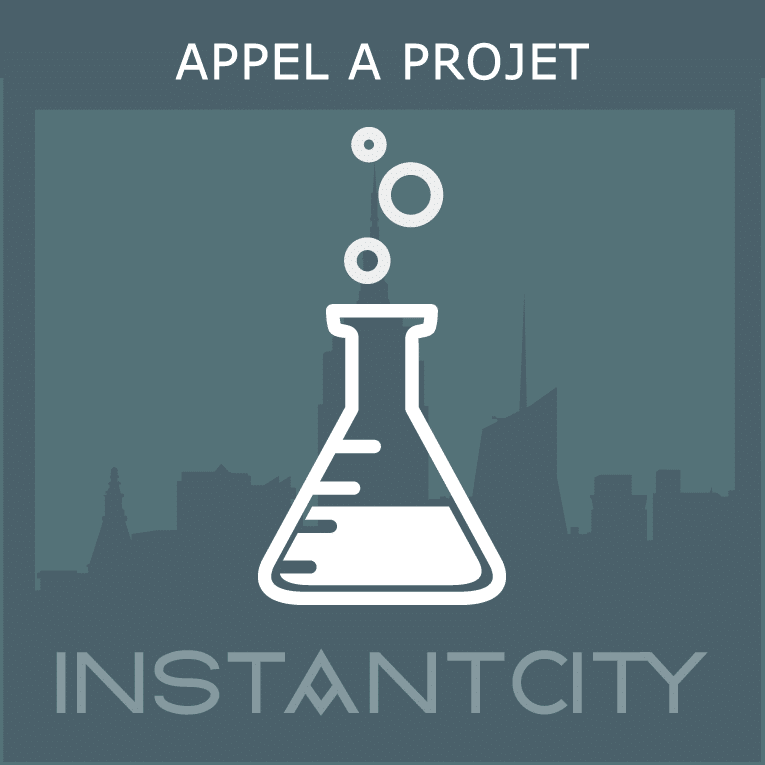


















 RSS - Articles
RSS - Articles